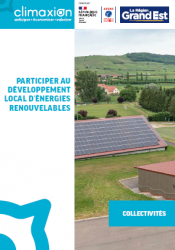ENGIE a récemment missionné l’IFOP, institut de sondage, pour mener une enquête de grande ampleur afin d’objectiver les perceptions des énergies renouvelables. Dans le Grand Est, les résultats de l’enquête démontrent que les habitants ont une image positive des énergies renouvelables mais souhaitent également encore plus de preuves concrètes.
Depuis la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, la transition énergétique s’impose en France comme un impératif à la fois climatique et stratégique. Porteuse d’un héritage industriel important, la région Grand Est repose aujourd’hui sur une économie diversifiée mêlant industrie, agriculture ou encore activités transfrontalières, et mise de plus en plus sur les énergies renouvelables. Le territoire est leader dans l’éolien terrestre, connait un fort développement du solaire et de la méthanisation. La région se positionne ainsi comme un territoire de transition, entre héritage industriel et production énergétique plus durable avec plus de 51% de la consommation d’électricité couverte par la production régionale d’énergies renouvelables. Mais comment sont réellement perçues les énergies renouvelables dans le Grand Est ?
L’étude menée par ENGIE avec l’IFOP met en lumière la place stratégique qu’occupe la question énergétique : près d’un habitant du Grand Est sur deux (47 %) identifie l’énergie comme une priorité majeure.
Jugée « très importante » par près de 7 répondants sur 10, la souveraineté énergétique s’impose comme une priorité. Ce positionnement central reflète une prise de conscience que l’énergie conditionne à la fois la stabilité économique, la lutte contre le changement climatique et l’indépendance territoriale.
Une image positive des énergies renouvelables
Les énergies renouvelables bénéficient d’une perception positive indiscutable dans la région Grand Est, tout comme dans le reste de la France. En effet, 84 % en ont une bonne image, dont 24 % une très bonne image.
D’ailleurs, toutes les énergies renouvelables arrivent en tête des sources d’énergie les mieux perçues ; loin devant le nucléaire et les énergies fossiles. L’hydraulique (89 %), le solaire (89 %) et la géothermie (85 %) ont une excellente image. Le gaz vert (80 %) et l’éolien (79 %), un peu en retrait, restent très bien perçus, portés par une région particulièrement active dans le développement de l’éolien terrestre, notamment dans l’Aube et la Marne.
Cette image positive s’appuie sur des bénéfices bien identifiés comme la lutte contre le changement climatique (80 %), la souveraineté énergétique (77 %) ou la dynamisation de l’économie locale (73 %).
En plus de leur bonne image et d’un essor déjà bien engagé dans la région, les habitants du Grand Est soutiennent une montée en puissance des énergies renouvelables :
- 61 % jugent leur déploiement actuel insuffisant,
- 66 % souhaitent que les EnR se développent davantage dans les 5 prochaines années.
Proximité et adhésion
Contrairement aux idées reçues, vivre à proximité d’une infrastructure d’énergie renouvelable ne génère pas systématiquement du rejet. Au contraire, l’étude montre que les riverains ont une meilleure image des EnR que les autres.
Cette familiarité directe :
- Renforce la compréhension de leur fonctionnement,
- Permet de relativiser les craintes généralement exprimées (bruit, détérioration du paysage, odeurs, impact sur la faune et la flore),
- Favorise une évaluation plus équilibrée des bénéfices et des nuisances.
Pour que l’adhésion de principe au développement des EnR se traduise en soutien franc et durable, les citoyens attendent des preuves concrètes et visibles. Ils souhaitent avant tout constater des effets tangibles sur leur facture, des contreparties financières et des bénéfices économiques directs pour leur territoire. Dans la Marne, département concentrant une grande partie des éoliennes de la région, les habitants se montrent d’ailleurs particulièrement sensibles à ces attentes de retombées concrètes et de bénéfices locaux.
Par ailleurs, plus de ¾ des habitants du Grand Est souhaitent disposer d’informations plus claires, accessibles et neutres, illustrant une exigence de transparence.
L’adhésion passe dès lors par la preuve, la co-construction et la démonstration sur le terrain que les promesses des EnR peuvent se concrétiser, pour les citoyens comme pour les territoires.
L’étude met en lumière l’ouverture des habitants du Grand Est, et plus largement des Français, aux énergies renouvelables : une grande majorité en a une image positive et souhaite que leur développement s’accélère.
Le défi est désormais de transformer cette adhésion en une conviction durable, par une transition énergétique vécue, partagée et démontrée au plus près des territoires.